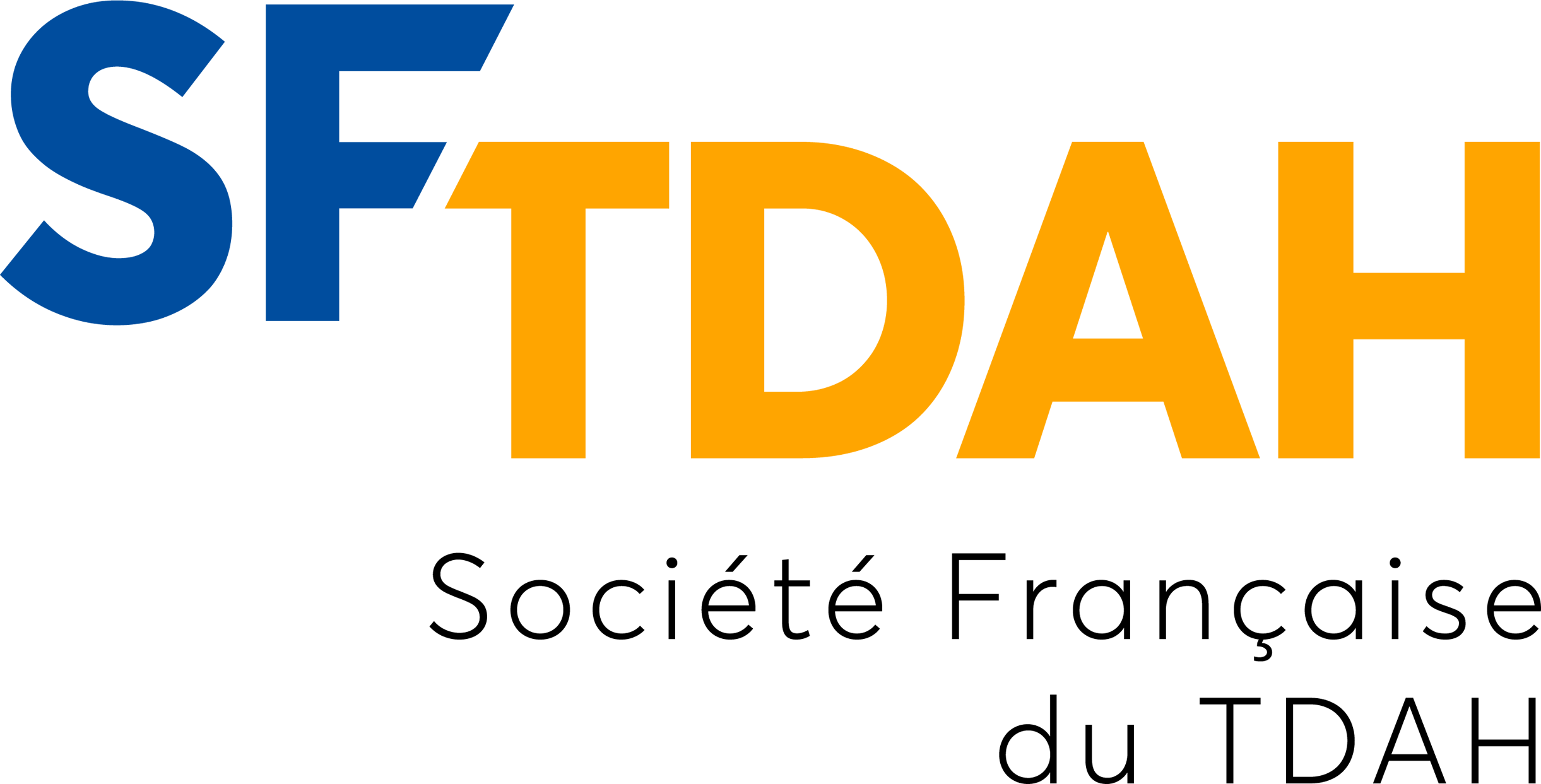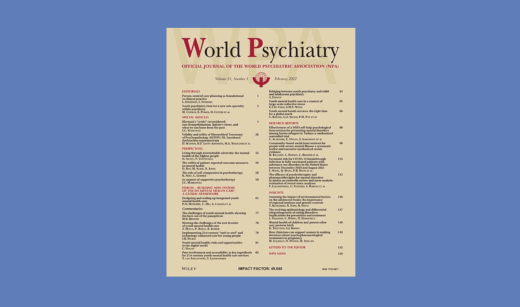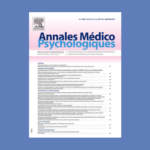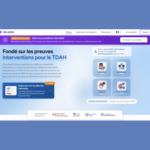Retrouvez ci-dessous le lien vers le l’article “Attention‐deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults: evidence base, uncertainties and controversies” :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.21374
Abstract en français :
Le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) était autrefois considéré comme une affection exclusivement infantile. Il est désormais bien établi qu’il peut persister à l’âge adulte, avec une prévalence mondiale estimée à environ 2,5 %. De plus, jusqu’à 70 % des personnes atteintes de TDAH d’apparition infantile continuent de présenter des symptômes invalidants à l’âge adulte, même si elles ne répondent plus aux critères d’un diagnostic formel. La validité du TDAH chez l’adulte a initialement fait l’objet de vives critiques. Aujourd’hui, la recherche empirique confirme sa validité descriptive (identification des signes et symptômes caractéristiques), sa validité prédictive (concernant les résultats spécifiques, l’évolution et la réponse au traitement) et sa validité concomitante (preuves relatives à ses causes sous-jacentes et à ses mécanismes biologiques). Malgré ces progrès, des questions non résolues et des débats persistants subsistent concernant le TDAH chez l’adulte. Cet article résume les données empiriques actuelles, ainsi que les incertitudes et les controverses, concernant la définition, l’épidémiologie, le diagnostic, l’étiologie, la neurobiologie et la prise en charge du TDAH chez l’adulte. Il est crucial de noter que nous incluons également les perspectives des personnes vivant avec cette affection, en soulignant leurs points de vue sur les besoins non satisfaits et les priorités pour améliorer les soins. Les principales incertitudes et controverses concernant le TDAH chez l’adulte portent notamment sur :
a) la possibilité d’un TDAH d’apparition tardive ;
b) l’importance de la dysrégulation émotionnelle comme symptôme central ;
c) la définition et la caractérisation du handicap fonctionnel ;
d) la persistance des comorbidités psychiatriques et somatiques après prise en compte des facteurs de confusion ;
e) la pertinence du dysfonctionnement exécutif dans la définition de l’affection ;
f) l’utilisation de mesures diagnostiques objectives ;
g) les effets à long terme des traitements ;
h) le rôle des interventions non pharmacologiques.
Des recherches supplémentaires sur le TDAH chez l’adulte sont urgemment nécessaires. Le financement des études sur cette affection est inférieur à celui consacré au TDAH chez l’enfant et aux autres troubles mentaux de l’adulte. Il est à espérer que les efforts des cliniciens, des chercheurs et des autres parties prenantes contribueront à une meilleure compréhension, un meilleur soutien et une meilleure autonomisation des adultes atteints de TDAH.